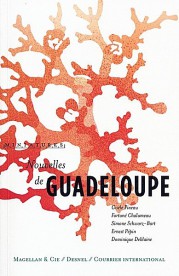Chronique-Recension
Par Dominique Chancé - Maître de Conférences - Université Bordeaux Montaigne
Dominique Chancé est auteure de nombreux articles et ouvrages sur la littérature antillaise
Document Adobe Acrobat [11.7 KB]
Document Adobe Acrobat [2.4 MB]
(1er extrait)
On dit que je suis un homme à moitié esquissé, à moitié fini, entre espoir et résignation. Certains disent que je crois qu’aimer, c’est marcher le cœur en dérade à côté d’un précipice sans fin, traverser des rivières en crues, voler sans ailes et respirer à la manière des poissons. D’autres encore disent que je crois qu’aimer c’est dislocation d’harmonie, écœurement des lignes, des courbes, des couleurs, frustration d’un tableau qui se dérobe le jour et écorche la nuit, perte de temps et tourments. Il paraît que je ne sais pas qu’il faut des étincelles dans les yeux comme du sang dans les veines, qu’il faut de l’or dans la voix comme de l’air, du boire et du manger, qu’il n’y a que frénésie, souffrance, amour, et qu’il me faudra, paraît-il encore, errer, me débattre, hurler en silence qui voudrait de ma solitude, qui accepterait ma peine ?
Il y a presque trente ans, j’avais fui la Guadeloupe pour Montréal, vomi ses hommes enfiévrés aux poitrines gonflées d’orgueil, ses femmes bâtées d’inquiétude, ses disputes machinalement inopinées, ses tollés bourgeonnant à chaque coin de rues, sa putréfaction des cases borgnes, et pire encore son soleil épineux, son air flamboyant et ses ciels cobalt. Je me saoulais de ces visions lorsque la nostalgie me traquait dans les rues cinglées par le froid et inondées de neige fraîche ; m’enivrais de ces cauchemars quand la mélancolie me taraudait. Chasser les fragrances des vanilliers, les senteurs des fruits, les exhalaisons des plats de porc, les ragoûts de cabrits, les rythmes du ka, les chantés Noël, mais surtout le concert assourdissant des grenouilles dès la tombée du jour, n’est pas donné à tous. Au bout de trois ans dans la ville du froid, j’étais revenu à Basse-Terre. Séduit par les manières et l’allure d’une femme, Éliamée, tiraillé par le désir de vivre intensément après la tourmente qui m’avait ramené de force dans ces paysages et ce climat que je trouvais malgré tout pesants et violents, j’avais vécu trois mois dans une insouciance et une euphorie dont je ne me serais pas cru capable. Et un enfant s’installa dans le ventre d’Éliamée. Un enfant, sans le vouloir, simplement parce que j’avais aimé la douceur d’une peau particulière… le charme ne pouvait pas durer. Je rejoignis Montréal, oubliant tout du regard et de la peau que j’avais aimés, ne me souciant guère de mon fils, Fortuné, jusqu’au jour où celui-ci, dans sa vingt-cinquième année, avait eu, lui aussi, un fils. Voilà, tout comme les oiseaux de nuit succèdent à ceux du jour, j’avais eu un fils qui avait suivi le même chemin. Deux semaines durant j’avais pesté contre ce fils, contre moi-même aussi, contre la vie en somme. Je ne voulais pas être grand-père et je me fichais pas mal de ceux qui croient au renouvellement de la vie, à la clarté des matins ou à la lueur du crépuscule, comme ils disent avec leurs grandes phrases gnangnan. Tout cela m’agace. Préférant le calme, la tranquillité et la solitude, je me tins à l’écart de cette famille agrandie. Déjà, dès ma seizième année, j’avais décidé que ma route ne serait pas troublée par des sentiers que je n’avais pas tracés. Le seul chemin que je voulais suivre était celui de la peinture. Mais la passion est une drôle d’aventure : à l’exaltation de la création se mêle la perte de l’innocence, et le bonheur de connaître révèle souvent avec cruauté les différences et les inconciliables. Ainsi, en à peine deux ans, j’avais marché-marché sur mon rêve et j’étais arrivé à la limite du territoire familial, un territoire rassurant dans le passé, désormais étrangement incompréhensible. C’est avec honte que je pris conscience que l’amour que je portais à mes parents diminuait de jour en jour au fur et à mesure que grandissait ma passion pour la peinture. La jeunesse prépare-t-elle vraiment à la vie d’homme à matrité ?
(2e extrait)
Le pitt où Layé m’amena était de taille : il pouvait contenir au moins cent personnes, en comptant les gradins et le balcon. La terre battue de l’arène était recouverte d’une moquette rouge ; il paraît qu’ainsi les coqs ne sont pas gênés par la poussière qui peut parfois se dégager de la terre battue, même très ferme, presque aussi dure que le ciment. Layé dit que l’aire rouge est la préférée de tous, car elle attise la fureur des coqs et celle des parieurs : les coqs sont survoltés ; les yeux des hommes s’injectent de sang, la sueur apparaît soudainement sur leur front, sous leurs aisselles, leurs mains se crispent, leurs doigts comptent sans cesse les chances de leur favori et les gains possibles. J’étais stupéfié, mais lui me dit que ce n’était rien comparé aux pitts de Porto-Rico où mille personnes et plus pouvaient s’installer, où il y avait même des ascenseurs pour amener les coqs jusqu’à l’aire de combat.
Layé ne présenta que quatre coqs ce jour-là. Il avait amené un gros-sirop, un cendre, un giraumon et un madras, disant que ce mélange de couleurs lui portait chance. Le premier présenté fut le cendre. Suivant le règlement, il lui avait épilé les cuisses et une partie du dos. Pour l’élégance il avait taillé une belle collerette, pour la sécurité il avait arrangé la crête et les bajols, pour l’agilité il avait égalisé la queue. Tout cela donnait véritablement au cendre l’allure du coq de combat. Pas un détail ne manquait. D’ailleurs, après la pesée, son sourire disait combien il était content-content de son coq de bon calibre. Le cendre, qui faisait un kilo sept cent quatre-vingts, fut marié avec celui de Timothée, qui n’atteignait qu’un kilo six cent soixante. Tous deux préparèrent leurs coqs, passèrent sur leur corps le coton imbibé d’éther, au cas où il y aurait eu un poison sur les cuisses ou sur les plumes pour mettre à bas l’adversaire, puis ils firent avaler un bout de ce coton à chacun des coqs. Si aucun d’eux ne mourait, c’était bon signe. Layé posa rapidement les zépons, ces ergots de quatre centimètres, car il est préférable, dit-on, d’être le premier prêt pour choisir le bon bord. On croit que le bon coin aide à la victoire du coq.
Tout alla très vite, on enleva l’attirail au milieu du pitt, Layé et Timothée firent le dernier becquetage pour que les coqs deviennent ardents. Au premier rang, les juges et les responsables des listes des paris étaient là, et Layé lorgnait de leur côté. La sonnette s’agita, les ampoules s’allumèrent, les deux coqs se jetèrent l’un sur l’autre avec d’effroyables battements d’ailes, de sauts, de lancées de pattes et d’étirements de cous. Chaque coq cherchait les points faibles de l’autre. La seule envie ici, au milieu, c’est tuer. La lutte était terrible, pleine de rage, et c’était la même fureur qui envahissait sourdement la foule. Par moments, elle retenait ses cris, mais je les entendais malgré tout dans ces silences tout aussi insupportables. Déjà mon souffle devenait difficile. Tout dans ce pitt sentait la sueur, la cire chaude et l’éther. Rapidement, le coq de Timothée eut les deux yeux crevés, courut dans tous les sens, reprit le combat, se défendit et repartit en dérade. La foule criait. Les paris montaient. Layé, lui, ne criait pas encore victoire, il était attentif, car on avait parfois vu l’estropié donner le coup de grâce à l’autre. Les colonnes pariaient et quelques hommes, même s’ils étaient déjà inscrits sur une des deux listes, continuaient à parier à la criée ; le sang chauffait, les gorges étaient assoiffées. Certains hommes pestaient, disaient que le coq de Timothée n’était vraiment pas à la hauteur, que c’était une honte, que le coq de Layé était surnaturel, que s’en était trop de son écurie. Ils ne savaient plus quoi penser. Ceux qui avaient parié sur le coq de Layé avaient un sourire dans les yeux, attendaient le coup qui mettrait fin au combat et remplirait leurs mains de beaux billets. Et lorsque le coq de Layé abattit celui de Timothée, les cris de joie se mêlèrent à ceux de la déception. Mais déjà, c’était du passé et tous les hommes se ruaient pour d’autres paris.